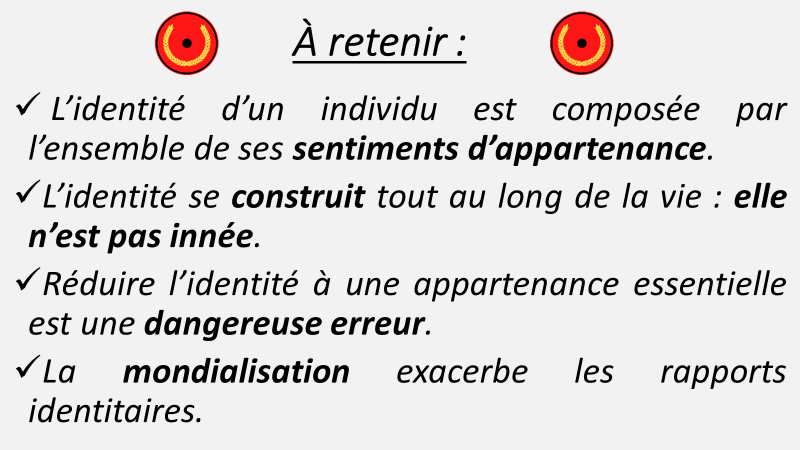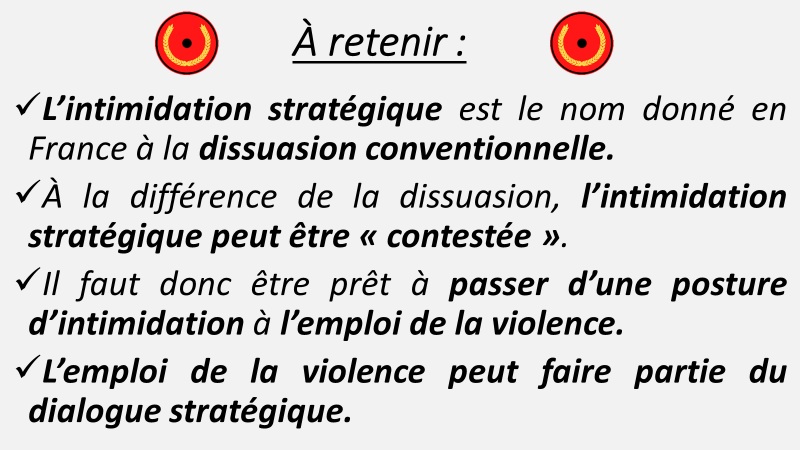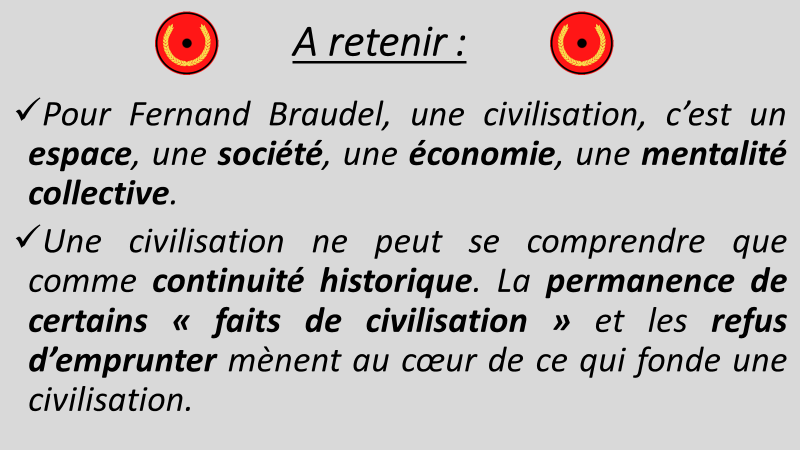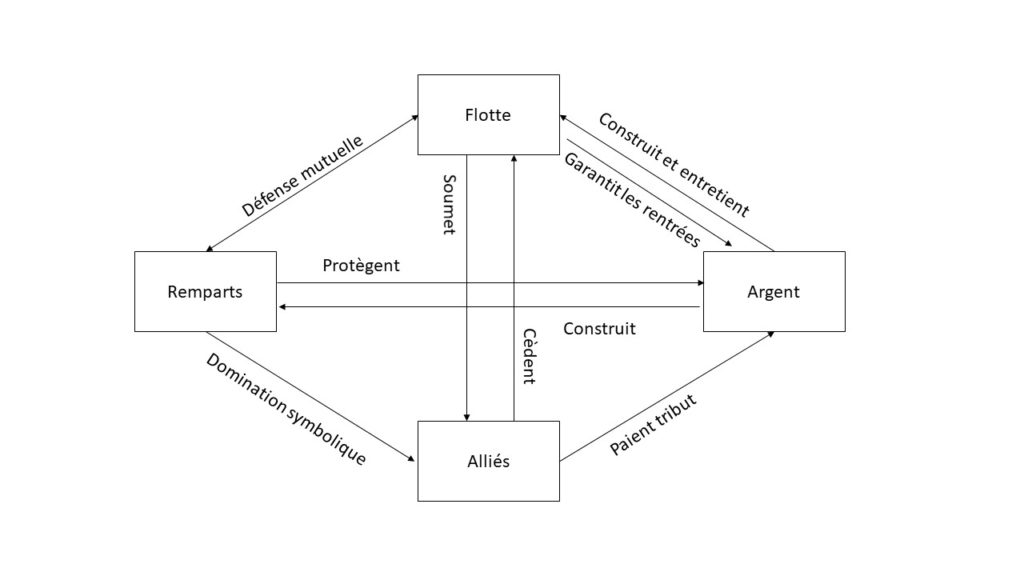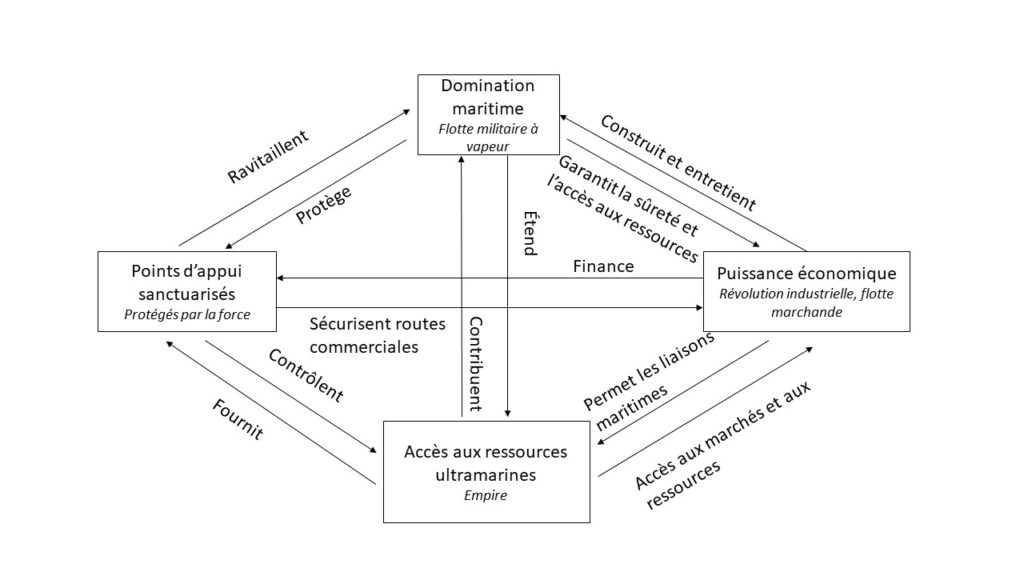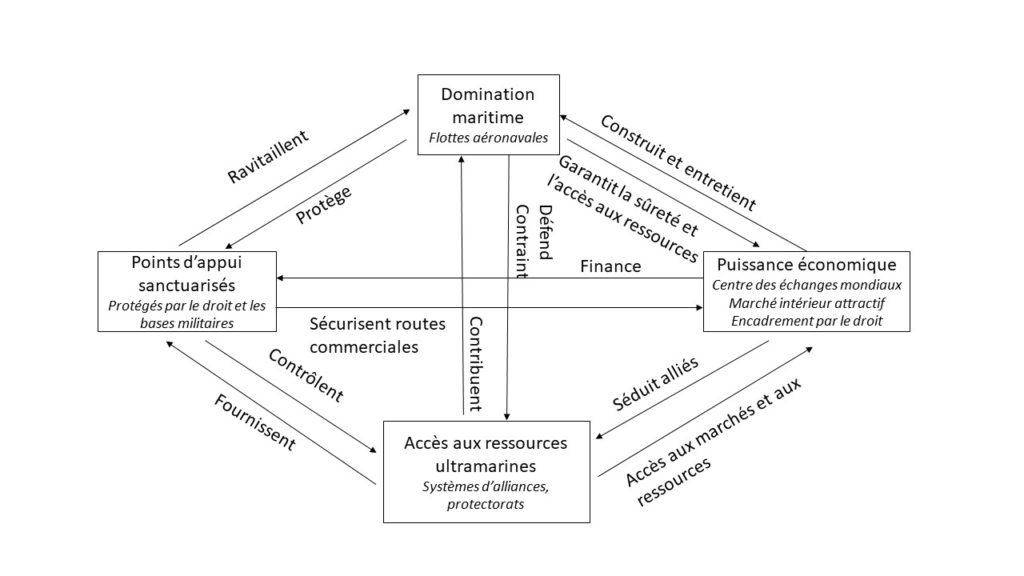Depuis 2014, on voit fleurir les mots de « guerre hybride » un peu partout pour qualifier… un peu n’importe quoi ; enfin, du moment que ça vient d’en face.
Cette notion est l’exemple même du concept fourre-tout, à qui l’on fait dire beaucoup de choses. Mais ça tombe bien, parce qu’au niveau politique, c’est à cela qu’il sert.
Alors, la guerre hybride, c’est quoi ?
Aux origines de la guerre hybride
Les inventeurs de la guerre hybride
Le concept de guerre hybride est popularisé par un article du général Mattis et du lieutenant-colonel Hoffman en 2005, « Future Warfare : The Rise of Hybrid Wars »[1]. S’ils ne sont pas les premiers à parler de « guerre hybride »[2], ce sont bien eux qui vont porter ce thème dans le débat stratégique.
L’article initial, rédigé en pleine guerre d’Irak, vise à peser dans les réflexions en cours sur la « Quadriennal Defense Review » de 2006[3], et possède donc déjà une portée très politique. Le Pentagone avait identifié plusieurs types de menaces pour les États-Unis : traditionnelle, irrégulière, catastrophique et disruptive. Les auteurs font remarquer qu’il est très probable que les futurs adversaires des États-Unis emprunteront leurs procédés aux différentes catégories édictées, plutôt que de se fondre dans une identification complète à un type de menace. Ils font également remarquer que la dimension informationnelle prendra une place tout à fait essentielle dans les conflits de demain.
De la guerre hybride aux menaces hybrides
Peu à peu, la communauté stratégique s’est saisie du concept et a qualifié plusieurs conflits pourtant très différents d’« hybrides ». La guerre du Liban en 2006 a montré qu’un belligérant non étatique et irrégulier pouvait tout à fait utiliser des matériels jusque-là a priori réservés aux armées nationales[4].
Puis, en 2014, les opérations menées par la Russie en Ukraine ainsi que son soutien aux séparatistes du Donbass et de Lougansk sont l’occasion d’un glissement du concept de guerre hybride. Il est cette fois caractérisé par la combinaison de moyens militaires et non militaires dans le but d’agir pour déstabiliser un État tout en restant sous le seuil de la guerre.
La définition de la guerre hybride a donc varié avec le temps[5]. Mentionnons tout de même celle proposée par Guillaume Lasconjarias, particulièrement complète :
« le conflit hybride est avant tout une combinaison entre des moyens conventionnels, irréguliers et asymétriques, jouant sur les champs idéologiques et politiques comme informationnels pour manipuler en permanence les perceptions, et combinant forces spéciales et forces conventionnelles, agents de renseignement et provocateurs politiques, médias et acteurs économiques, cyberactivistes et criminels, paramilitaires et terroristes. L’objectif est donc de mener un effort offensif et global contre un pays, un état ou une institution, en l’affaiblissant via une crise permanente, une insurrection, une crise humanitaire ou politique grave, voire une guerre civile[6]. »
La guerre hybride, un concept militairement peu utile
La guerre hybride, c’est… la guerre
Si l’on doit reconnaitre que ce concept peut être tout à fait valide, par exemple lorsqu’il décrit tout l’éventail des actions possibles entre la guerre régulière et la guerre irrégulière[7], il faut tout de même conclure qu’il n’amène rien de nouveau.
En effet, les actions régulières et irrégulières sont combinées depuis l’antiquité[8] ; quant à la combinaison des moyens militaires et non militaires, elle est incluse dans la stratégie intégrale du général Poirier[9] (lien poirier) ; enfin, les stratégies de déstabilisation sont aussi vieilles que la politique. Concernant l’emploi des matériels les plus modernes ou des technologies duales par des acteurs non étatiques, la « techno-guérilla », pense-t-on que les guérillas d’hier se contentaient d’armes démodées capables seulement de faire un peu de bruit ?
La guerre hybride, la mise en boîte de trop ?
Qui plus est, cette notion floue pourrait aussi bien être contre-productive. En effet, l’engouement pour la notion de guerre hybride est certainement imputable à la nécessité structurelle pour l’analyste de classer et de catégoriser. Analyse est par définition identifier les parties d’un tout et leurs relations.
Or, si l’analyse théorique est un préalable indispensable pour former l’instinct des chefs[10], ces classifications dans des classifications pourraient s’avérer contre-productives pour des praticiens qui ont à faire à chaque fois à un conflit nouveau, unique, à une nouvelle couleur du caméléon clausewitzien, et qui doivent à tout prix résister à la tentation d’exhumer une liste d’actions à mener en fonction de tel ou tel type de conflit[11]. Une multiplication des concepts et des cadres d’analyse, aussi satisfaisante qu’elle soit sur le plan intellectuel, pourrait mener à des erreurs d’appréciation par l’application de grilles de lecture préformées. Paradoxalement, peut-être était-ce là l’enseignement de l’article du général Mattis et de lieutenant-colonel Hoffman…
Aussi aujourd’hui le thème de l’hybridité est-il abordé avec circonspection. Par exemple, le Pentagone a renoncé à en rédiger une doctrine[12], quant à la France, si elle emploie le terme de « menace hybride », on ne le retrouve mentionné que dans un seul document de doctrine militaire[13], rédigé en 2015 alors que la mode de l’hybridité faisait fureur. Il ne fait pas l’objet d’un document de doctrine particulier. Le Revue stratégique quant à elle ne l’emploie qu’une fois[14], ce qui montre que ce terme n’a pas véritablement réussi à s’imposer dans l’hexagone.
La guerre hybride, une ressource politique[15] de grande valeur
En revanche, au niveau politique, le concept fait figure de pépite. Né dans des publications américaines, le terme a vite été repris notamment par l’Union européenne et l’OTAN.
Caractériser l’agression
D’une part, l’Alliance montre qu’elle est plus que jamais nécessaire, puisque les frontières européennes peuvent à nouveau être l’enjeu d’un conflit. D’autre part, le concept de guerre hybride, en mêlant menaces non militaires et militaires, crée un continuum de la conflictualité en temps de paix. Cela permet à l’Alliance de se mettre en capacité de répondre avec ses moyens militaires aux défis posés en Europe de l’Est.
Le terme de guerre hybride a le mérite de mettre les Occidentaux, et spécialement les Européens, face à la réalité qui est la leur et qu’ils n’ont pas toujours voulu voir. Tout le monde ne conçoit pas la paix comme une coexistence irénique. Or l’Union européenne s’est construite sur la promesse de la fin de la guerre en Europe ; elle a le plus grand mal à concevoir les relations extérieures sous le prisme des rapports de puissance. Il en va de même pour un certain nombre de nations européennes qui n’ont plus connu de conflit armé depuis la Seconde Guerre mondiale. Mettre un nom sur des tentatives indéniables de déstabilisation ou de prise de contrôle est un pas en avant significatif vers une compréhension du monde adéquate pour pouvoir dialoguer de façon réaliste avec ses voisins.
Enfin, les « menaces hybrides » sont en fait une ressource politique qui offre la possibilité d’unifier les visions stratégiques des Européens. Elles permettent d’unir les menaces auxquelles font face les nations européennes, que ce soit à l’est avec des tentatives de déstabilisation russes ou le terrorisme islamiste. Cette unification des points de vue, si difficile à obtenir en Europe, permet la mise en place de politiques de résilience.
Un terme lourd de sens
En effet, « hybride » n’est pas un mot neutre. Il est porteur d’une forte charge négative. L’hybride est ici une recomposition, presque contre nature, de plusieurs ensembles qui n’étaient pas destinés à se côtoyer ; il s’agit presque d’un objet mutant, si indéfinissable qu’il en est incontrôlable. En effet, étymologiquement le mot proviendrait d’un rapprochement entre le latin hy̆brida (« de sang mêlé ») et le grec υ ́ϐρις « violence ».
La charge d’angoisse que « l’hybridité » véhicule est un facteur qui délégitime celui qui la met en œuvre. L’Occident ne pratique donc pas ce type de guerre, mais l’« approche globale », dont la guerre hybride a quasiment été définie comme le « double maléfique » par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN :
« [la guerre] hybride est le pendant obscur de notre approche globale. Nous employons une combinaison de moyens militaires et non militaires pour stabiliser des pays. D’autres s’en servent pour les déstabiliser »[16].
Jens SToltenberg, secrétaire général de l’OTAN, 2015
Le terme « hybride » possède donc indéniablement une charge morale forte qui favorise le rassemblement contre les auteurs d’actes « hybrides ».
La guerre hybride, la guerre des autres
La guerre hybride, c’est la guerre des autres. Personne ne se réclame d’une doctrine de guerre hybride. Les opérations militaires occidentales, qui allient forces conventionnelles, forces spéciales, partenariat militaire opérationnel (former et employer les troupes locales au combat), soutien à des groupes paramilitaires, guerre de l’information, investissement économique, parfois appui des ONG, et quelquefois même mensonge d’État, comme lors de la guerre d’Irak de 2003, possèdent pourtant toutes les caractéristiques de la guerre hybride.
Les Russes, eux, n’emploient pas le terme de guerre hybride, mais de guerre de nouvelle génération (ou guerre non linéaire).
*
Sans revenir sur tous les travaux et les controverses à son sujet, nous conclurons que l’hybridité est un concept peu utile militairement. Tout en restant flou, il tente de décrire comme révolutionnaire une réalité aussi vieille que la guerre. Considérons donc l’hybridité comme une notion plus que comme un véritable concept, une notion évoquant une forme de conflictualité marquée par l’ambiguïté.
En revanche au niveau politique c’est une notion particulièrement utile, ce qui peut contribuer à expliquer son succès.
Voir aussi qu’est-ce que la guerre asymétrique.
*
[1] Mattis, J. N., & Hoffman, F., « Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars », Proceedings, vol. 131, n° 11, novembre 2005.
[2] Walker, R. H., SPEC FI., « The United States Marine Corps and Special Operations », Monterey, Naval Postgraduate School, 1998.
[3] Barbin, J., « La guerre hybride, un concept stratégique flou aux conséquences politiques réelles », Les champs de mars, 2018/1, 30, p. 109, et Alchus, T., « L’adaptation de l’OTAN aux menaces de « guerres hybrides » russes » [en ligne], CSFRS, 2019, disponible sur <https://www.geostrategia.fr/ladaptation-de-lotan-aux-menaces-de-guerres-hybrides-russes/>, (consulté le 19 avril 2020).
[4] Tenenbaum, E, « Guerre hybride : concept stratégique ou confusion sémantique », Revue de Défense Nationale, mars 2016, p. 32.
[5] Hoorickx, E., « Quelle stratégie euro-atlantique face aux « menaces hybrides »? », Revue de Défense Nationale, novembre 2017, pp. 118 – 122.
[6] Lasconjarias, G., « Qu’est-ce que la guerre hybride » [en ligne] disponible sur <https://www.anoraa.org/articles/20995-quest-ce-que-la-guerre-hybride>, (consulte le 25 avril 2020).
[7] Tenenbaum, E., Le piège de la guerre hybride, Focus Startégique, n°63, octobre 2015.
[8] Henninger, L., « La guerre hybride : escroquerie intellectuelle ou réinvention de la roue ? », Revue de Défense Nationale, mars 2016, pp 51– 55.
[9] Poirier, L., Stratégie théorique II, Paris, Economica, 2015, pp. 113 – 120.
[10] De Gaulle, C., Le fil de l’épée, Paris, Perrin, 2015 ; Von Clausewitz, C, De la guerre, Paris, Ivréa, 2000, pp. 131 – 132.
[11] Henninger, L.,« La guerre hybride… », op.cit., p. 54.
[12] Henninger, L., loc. cit.
[13] Armée de Terre, DFT 3.2, t. 1 (FT-03), L’Emploi des forces terrestres dans les opérations interarmées, Paris, CDEF, 2015
[14] Ministère des Armées, Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, Paris, Dicod, Bureau des Éditions, 2017, p. 47.
[15] ALCHUS, T., « L’adaptation de l’OTAN aux menaces de « guerres hybrides » russes » [en ligne], CSFRS, 2019, disponible sur <https://www.geostrategia.fr/ladaptation-de-lotan-aux-menaces-de-guerres-hybrides-russes/>, (consulté le 19 avril 2020).
[16] « Hybrid is the dark reflection of our comprehensive approach. We use a combination of military and non-military means to stabilize countries. Others use it to destabilize them. », Jens Stoltenberg, 25 mars 2015, disponible sur https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_118435.htm?selectedLocale=fr>, (consulté le 25 avril 2020). C’est nous qui soulignons.