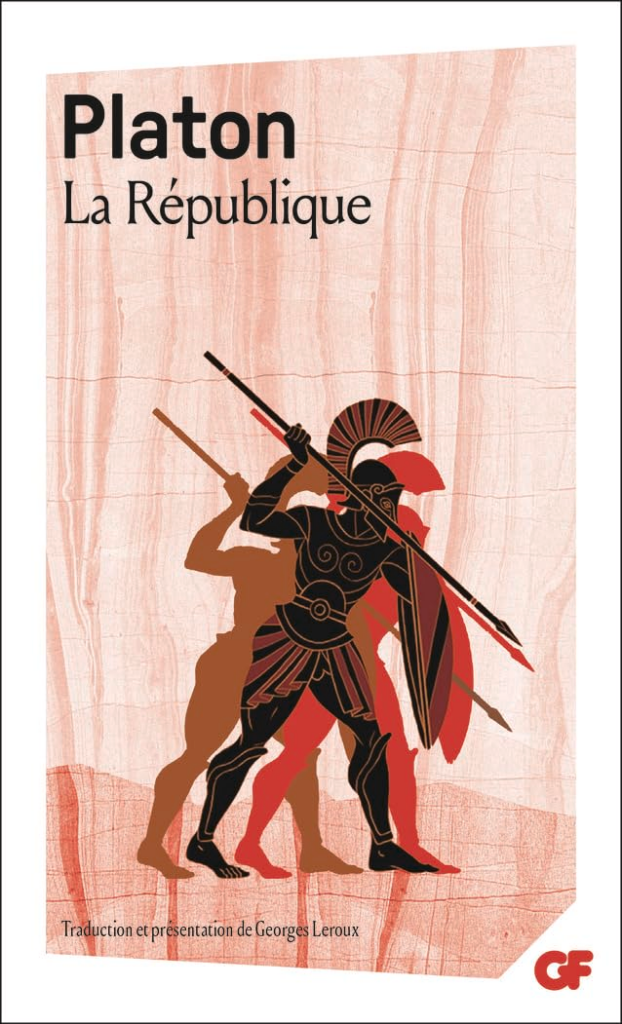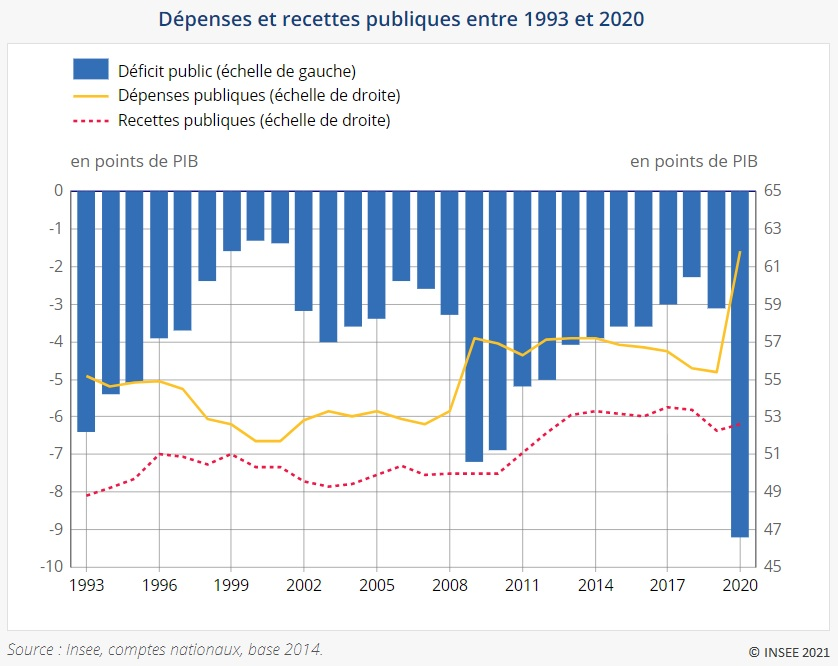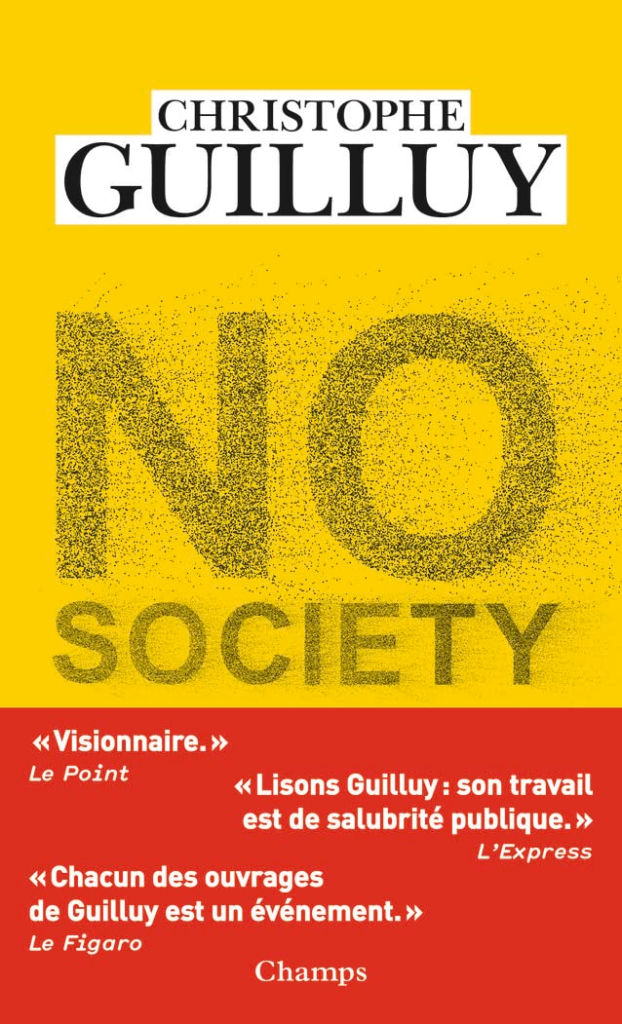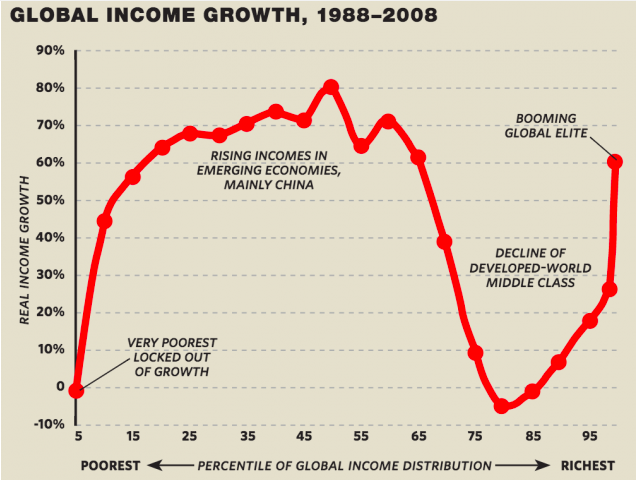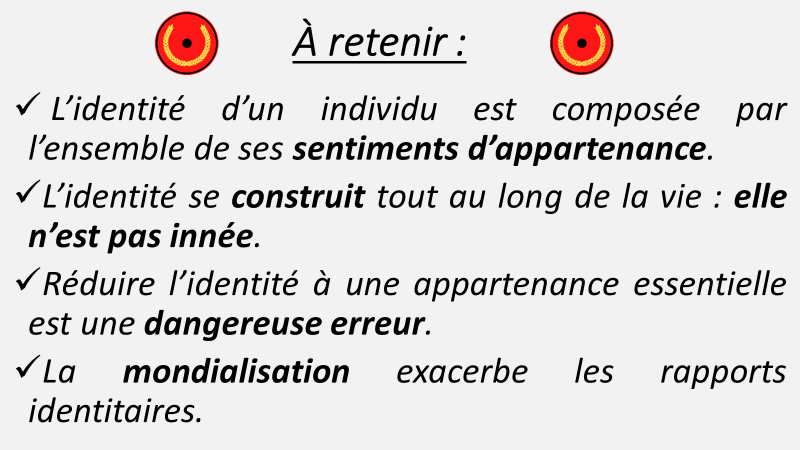Fahrenheit 451, œuvre phare de Ray Bradbury, prend place dans un monde d’où les livres sont bannis. Le personnage principal, Guy Montag, est pompier. Mais dans ce futur proche, les pompiers n’éteignent plus les incendies : ils brûlent les livres, pour le bien commun. Mais un jour, Montag va rencontrer Clarisse, une jeune femme différente, qui va lui ouvrir les portes d’un nouvel univers. La culture est donc un thème central du roman. Quelle est sa place selon Ray Bradbury ? A quoi sert la culture ?
Pour le résumé complet, c’est ici (à venir). Ceux qui auront parcouru l’ouvrage apprécieront l’ironie d’en proposer une synthèse. Attention, l’intégralité de l’intrigue est révélée. Vous pouvez aussi visionner l’adaptation de François Truffaut.
Pourquoi brûle-t-on les livres ?
Après une intervention particulièrement éprouvante, Montag sent naître en lui des doutes sur sa mission. Il reçoit alors la visite de son supérieur, le capitaine Beatty. Celui-ci lui avoue à demi-mot avoir lu, beaucoup lu. Il lui explique pourquoi la société a interdit les livres.
Au commencement, nul oukase, nul ordre venu d’en haut. Un mouvement beaucoup plus complexe a mené au bannissement.
Massification de la culture
Tout débute avec le phénomène de massification de la culture, qui provoque un nivellement par le bas, une simplification des productions. La recherche de la distraction, faible succédané de bonheur, a de plus imposé un rythme toujours plus dense, des sensations toujours plus fortes. Les œuvres de l’esprit en arrivent à ressembler à une « vaste soupe », faite d’impression vagues et de spectacle.
Ne pas blesser
Une littérature élitiste aurait pu survivre, mais c’était sans compter sur la forme socio-économique qu’avait prise le monde de la production intellectuelle. La fin de l’écriture a commencé le jour où l’on a porté trop d’attention aux sentiments des différents groupes qui composent la société. Afin de ne pas se priver d’une partie du marché, les acteurs économiques de la culture ont « lissé » les publications pour n’offenser personne. Les livres qui dérangeaient ont tout simplement perdu droit de cité.
Il en a résulté que les œuvres de l’esprit étaient devenues « un aimable salmigondis de tapioca à la vanille », qui n’avait plus rien à dire. Et qui n’a plus rien dit. C’est donc la place centrale de la recherche du profit qui a tué les livres, trop complexes, trop blessants pour continuer à faire de l’argent. Étonnante description de la cancel culture avant l’heure. Toute ressemblance avec une situation contemporaine ne serait que pure coïncidence…
C’est seulement ensuite que le pouvoir politique s’est engouffré dans la brèche. Il a reconverti les pompiers, au chômage technique parce que toutes les maisons étaient désormais ignifugées, et leur a demandé d’assurer à la société la tranquillité de l’esprit, et de brûler ces livres porteurs de querelles. Il facilitait par là le contrôle de la population.
Qu’y a-t-il dans les livres ?
Les pompiers brûlent les livres, soit. Mais les ouvrages de papiers ne sont qu’un symbole brandi par Bradbury. Faber, un ancien professeur d’anglais, aide Montag à dépasser l’objet-livre.
« Ce n’est pas de livres que vous avez besoin, mais de ce qu’il y avait autrefois dans les livres. […] Cela, prenez-le ou vous pouvez le trouver, dans les vieux disques, les vieux films, les vieux amis ; cherchez-le dans la nature et dans vous-même. »
Pour que la magie opère, le support importe peu. Mais à quelles conditions l’objet de culture se différencie-t-il de la « vaste soupe » servie sur les « murs écrans » du pavillon de Montag ?
Il a besoin de trois ingrédients : « Un, […] la qualité de l’information. Deux : le loisir de l’assimiler. Et trois : le droit d’accomplir des actions fondées sur ce que nous apprend de l’interaction des deux autres éléments. »
Les trois ingrédients de la culture
Un livre n’atteint pas nécessairement son objectif parce qu’il est un livre. Il doit révéler le réel, le rendre visible, même lorsqu’il prend la forme du roman, de l’œuvre d’art.
« Les bons écrivains touchent la vie du doigt. Les médiocres ne font que l’effleurer. Les mauvais la violent et l’abandonnent aux mouches. »
Ce contenu dépend donc directement du talent de l’auteur, mais également, comme expliqué par Beatty un peu plus haut, des conditions socio-économiques de réception de l’œuvre.
Ensuite, pour produire son effet, le bon livre a besoin d’un lecteur qui ait le loisir d’assimiler son contenu. Le temps de le lire, bien sûr, mais aussi la disposition d’esprit nécessaire pour passer du temps dans l’ouvrage et discuter avec lui.
Enfin, la culture est inutile sans la liberté politique d’agir. La culture n’est pas que connaissance théorique. Elle fonde l’action. Or, ni Montag ni Faber ne possèdent de prise sur leur vie.
À quoi sert la culture
Mais à quoi sert donc cette culture ? Les personnages mettent plusieurs fois en avant son inutilité. Le fait que les livres ne sont jamais d’accord entre eux. Qu’ils présentent des héros et des péripéties qui n’ont jamais existé. Ces ouvrages ne racontent « rien que l’on puisse enseigner ou croire ». La culture est par conséquent le lieu de l’imagination, du débat et du doute. De l’inutilité immédiate. Tout le contraire des connaissances utilitaires que les enfants du monde de Montag reçoivent à l’école.
Beatty révèle que leur société valorise certains savoirs, mais uniquement des connaissances factuelles. Maîtriser une masse de faits donne alors aux gens « l’impression de savoir penser ». Mais en réalité, ils en sont devenus incapables. Tous les personnages semblent aussi vides que leur conversation, interchangeables, ni morts, ni vivants, à l’image du limier, chien robot programmé pour tuer. Ils ignorent tout du monde, jusqu’à la guerre qui va éclater et ravager leur cité.
Quête de sens
Clarisse est l’un des seuls protagonistes vraiment vivants que l’on rencontre au début du roman. Elle parvient à observer le monde autour d’elle, dans le détail. Elle tranche avec ses concitoyens, qui, comme nous, en ont perdu l’aptitude. Où réside son secret ? Elle se place dans une perspective opposée à celle du reste de la société. Elle cherche à comprendre le pourquoi et non le comment.
Cette quête du pourquoi permet de relier les choses entre elles, de leur donner du sens. C’est ce sens qui manque cruellement dans le monde de Montag. Le contenu des livres « cousent les pièces et les morceaux de l’univers pour nous en faire un vêtement ». Ils mettent les faits en perspective et les agencent les uns par rapport aux autres. Le réel reprend de l’intérêt, et la vie toute sa saveur.
« Je ne parle pas des choses, avait dit Faber. Je parle du sens des choses. La, je sais que je suis vivant ».
Connaissance du monde
Plus prosaïquement, les livres servent aussi à obtenir la connaissance du monde. Aucun des protagonistes n’est capable d’expliquer pourquoi la guerre menace, ni même à quoi ressemble ce qui se trouve au-delà des murs de la cité. La culture permet d’aller plus loin que de l’expérience individuelle instantanée. Elle aide à « sortir de la caverne » et à développer une pensée personnelle.
La culture ne se veut pas immédiatement utile. Elle ne sert qu’à mieux comprendre le monde en donnant de la profondeur à ses perceptions.
Lire aussi Amin Maalouf, qu’est-ce que l’identité
Le sable et le tamis
Très vite, Montag se retrouve cependant confronté à un problème. Il se trouve incapable de retenir ce qu’il lit. Les mots ressemblent à du sable qui se déverse dans le tamis de son cerveau. Sans doute n’a-t-il pas consulté notre article… Cette interrogation est loin d’être anodine. Qui peut dire ce qu’il reste de ses lectures ? Les réflexions de Montag posent la question de la méthode, de l’état d’esprit avec lequel aborder la culture. La culture, comment ça marche ?
À la fin du roman, Montag rejoint un groupe de marginaux qui s’efforcent de sauvegarder les acquis de l’humanité en retenant un livre ou une partie d’une œuvre par cœur. Il y gagne un peu de sagesse et commence à percevoir le « mode d’emploi » de la culture.
Culture, vie et observation
Finalement, le contenu précis d’un livre importe peu. Ce qui compte, c’est la façon dont il nourrit la vie, dont il permet l’observation, la conscience du monde. Dans l’ouvrage, observation, vie et culture se trouvent inextricablement mêlées.
« Montag considéra le fleuve. Nous nous laisserons guider par le fleuve. Il considéra l’ancienne voie ferrée. Ou nous suivrons les rails. Ou nous marcherons sur les autoroutes maintenant, et nous aurons le temps d’emmagasiner des choses. Et un jour, quand elles seront décantées en nous, elles ressurgiront par nos mains et nos bouches. Et bon nombre d’entre elles seront erronées, mais il y en aura toujours assez de valables. Nous allons nous mettre en marche aujourd’hui et voir le monde, voir comment il va et parle autour de nous, à quoi il ressemble vraiment. Désormais, je veux tout voir. Et même si rien ne sera moi au moment où je l’intérioriserai, au bout d’un certain temps tout s’amalgamera en moi et sera moi. »
Observation du monde et « lente fermentation des mots » se nourrissent l’une l’autre, dans le temps long. Le seul effort nécessaire est de commencer à lire.
Mais comme pour un concours il faut bien citer les œuvres, vous trouverez notre article ici.
*
À quoi sert la culture ? Une société qui bannit les livres est donc une société qui perd la capacité à observer et comprendre le monde dans sa complexité. Elle cesse de vivre pour se contenter d’exister, redoutant l’inactivité qui révèlerait son vide profond, craignant de sentir passer le temps.
Mais la culture s’avère-t-elle un bouclier suffisant contre la barbarie ? Loin de là. L’humanité qui disposait des livres les a laissés brûler. Le professeur Faber, qui possède une grande sagesse, fait aussi preuve d’une grande lâcheté. La culture est nécessaire à la vie, mais seule elle ne préserve pas de l’abîme.
« Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes ».
Lire aussi Fernand Braudel, qu’est ce qu’une civilisation ?