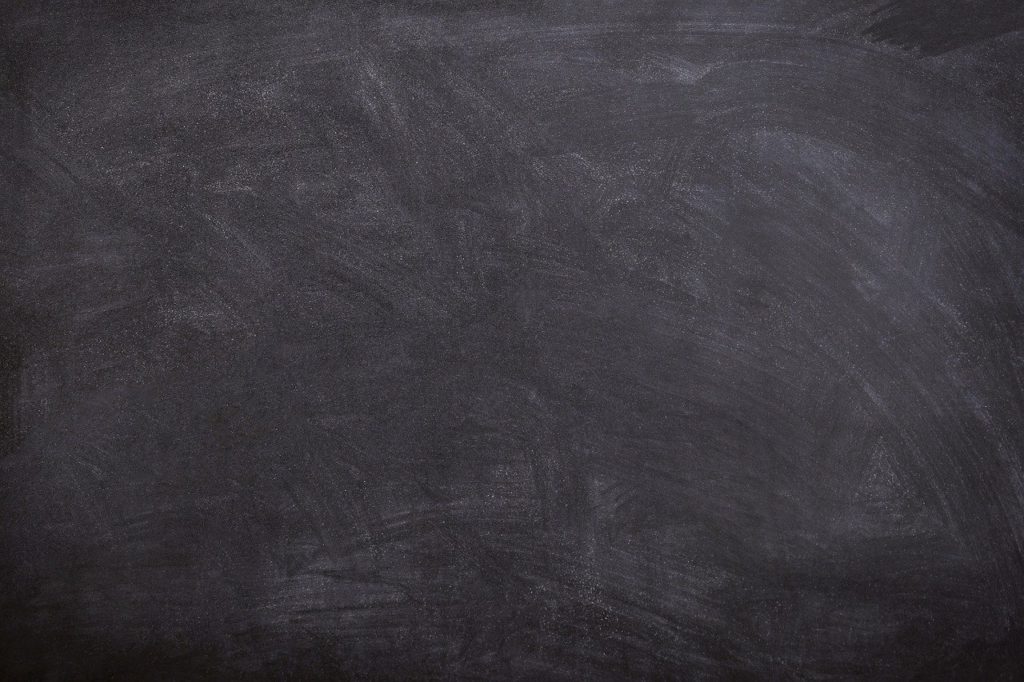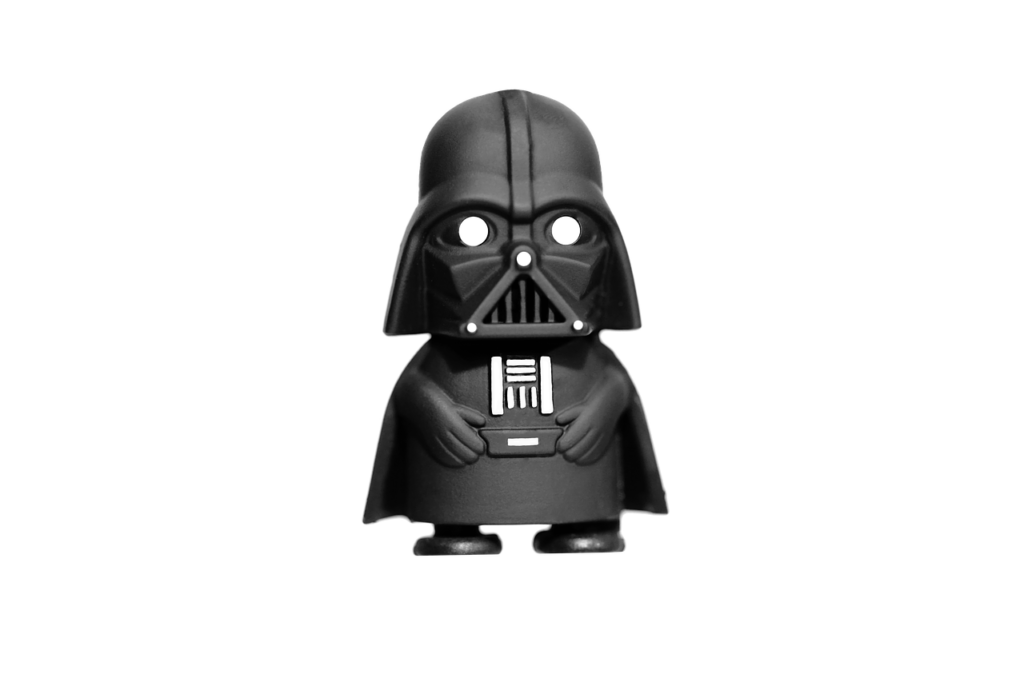Dans Grammaire des civilisations (1987), le grand historien Fernand Braudel (1902 – 1985) approfondit les concepts de culture et de civilisation.
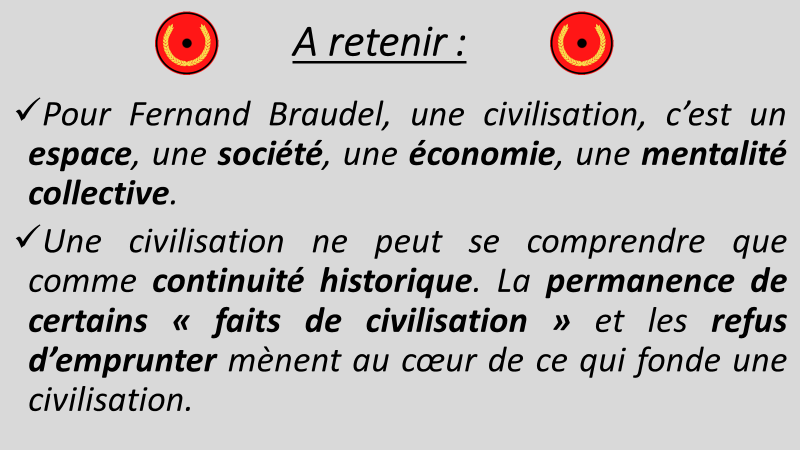
Civilisation et sciences sociales
Pour Fernand Braudel, une civilisation, c’est un espace, une société, une économie et une mentalité collective.
« Les civilisations sont des espaces »
L’espace est la « scène » de la pièce de théâtre. Une civilisation acquiert certaines de ses caractéristiques par sa réponse au défi posé par la nature. Elle choisit les meilleures solutions pour se loger, se vêtir, se nourrir. Par exemple, exploiter des rizières ou des champs de blé crée un certain nombre de contraintes qui façonnent les civilisations.
Cet espace est par conséquent aménagé. « Le milieu à la fois naturel et fabriqué pour l’homme n’emprisonne pas tout à l’avance dans un déterminisme étroit ». Le milieu, c’est donc des avantages donnés, mais aussi acquis.
« Les civilisations sont des sociétés »
Les notions de société et de civilisation sont entremêlées, et presque identiques. Toutefois, cette dernière suppose des « espaces chronologiques » plus vastes.
Ainsi, une des caractéristiques de la civilisation occidentale aujourd’hui est sa société industrielle. Cela n’a pas toujours été le cas. Dans cette optique sociologique, la relation ville/campagne est une des clefs de lecture des civilisations. Par exemple, le monde musulman a très tôt produit des villes brillantes, mais peu connectées avec les campagnes.
De plus, toute civilisation possède une vision du monde ; or, celle-ci est directement liée à la société, puisqu’elle est le fruit des tensions sociales dominantes.
« Les civilisations sont des économies »
Braudel comprend « économie » au sens d’économie politique. Il y inclut les enjeux technologiques et démographiques.
En effet, le rapport à la technique d’une civilisation pourrait être le produit de sa démographie. Ainsi, après la peste noire en Europe, le manque d’homme aurait stimulé l’inventivité technique. À l’inverse, la Chine, qui a toujours bénéficié d’une population très nombreuse, ou la Grèce antique, qui recourrait à l’esclavage, n’ont pas connu ces progrès des techniques malgré des civilisations brillantes.
En outre, une civilisation s’exprime dans la façon dont elle valorise ses surplus économiques, par l’art ou le luxe. Une économie, c’est une certaine manière de redistribuer les richesses, et donc une diffusion plus ou moins large de l’art, de la culture, de la philosophie et de la science. L’étendue de cette diffusion influera sur les aspects que prendra l’esthétique ou la philosophie. Par exemple au XVIIe siècle, l’art se concentrait autour des grandes cours ; au XIXe, il s’est répandu dans la bourgeoisie qui en a adapté les formes.
D’une façon plus générale, Braudel considère que c’est dans la vie intellectuelle de ses classes les plus pauvres qu’une civilisation se laisse lire le plus. « Le rez-de-chaussée d’une civilisation, c’est souvent son plan de vérité ».
« Les civilisations sont des mentalités collectives »
Cette notion de mentalité collective caractérise tout ce qui pour un peuple va de soi.
C’est la psychologie collective dominante qui « dicte les attitudes, oriente les choix, enracine les préjugés ». Elle est « le fruit d’un héritage lointain ».
À cet égard, la religion possède une importance clef, en définissant une éthique, en réglant les rapports à la vie et à la mort, mais aussi en assignant à chacun un rôle dans la société.
Il n’existe aucune frontière entre civilisations qui soit réellement imperméable. Les biens culturels s’échangent au même titre que les marchandises. Mais ces mentalités collectives sont « ce que les civilisations ont de moins communicable les unes à l’égard des autres ».
Cependant, à y regarder de plus près, la notion de civilisation n’est pas statique.
Lire aussi Les peuples ont-ils encore le droit de disposer d’eux-mêmes ?
La civilisation, une notion historique
Premièrement, le mot « civilisation » possède une histoire.
Au singulier
Dans son sens contemporain, il apparaît au XVIIIe siècle. Il désigne l’opposé de la barbarie.
Mais cette notion de civilisation possède deux étages : les œuvres de l’esprit, mais aussi les accomplissements concrets. « Apporter la civilisation », c’était à la fois imposer la vision du monde occidental et ses réalisations techniques, le christianisme comme les chemins de fer. Le besoin d’un autre mot s’est donc fait sentir. Ce fut la « culture ».
En France, le terme « culture » évoque essentiellement une forme personnelle de vie de l’esprit, tandis que la « civilisation » renvoie aux valeurs collectives. En Allemagne, Kultur se réfère à des idéaux, des valeurs, alors que Zivilisation se comprend comme un ensemble de techniques et de pratiques.
Au pluriel
Mais au XIXe siècle, le terme de civilisation passe au pluriel. La civilisation s’efface au profit des civilisations, des ensembles humains, comme la civilisation occidentale ou chinoise. Nous avons déjà expliqué sur quels critères s’identifient les civilisations. Mais elles se définissent aussi en sous-ensembles. Chaque dénominateur commun peut encore se décliner. Il existe au sein de la civilisation occidentale une civilisation française, américaine, espagnole, des toits de briques aux toits d’ardoises, du blé, du riz…
Les civilisations sont des continuités historiques
Ensuite, une civilisation n’est pas qu’un espace, une société, une économie et une mentalité collective prise à un moment particulier. On ne peut véritablement saisir son essence que dans sa dynamique historique.
Selon Braudel, c’est même là que l’on va pouvoir s’approcher au plus près de l’âme d’une civilisation. « L’histoire d’une civilisation […] est la recherche, parmi les coordonnées anciennes, de celles qui restent valables aujourd’hui encore ». Elles se manifestent à travers des faits de civilisation : le succès d’un livre, un progrès technique, une mode… Ces « faits » sont souvent éphémères, mais certains noms semblent défier l’histoire : Aristote, Descartes, Marx, Bouddha, Jésus, Mahomet… Ce sont eux qui peuvent nous guider vers les coordonnées toujours actives, vers ce qui ne varie pas, ou peu.
Outre ces « faits de civilisation » qui bravent le temps, ce sont leurs « refus d’emprunter » qui mènent au cœur des civilisations. Dans la longue durée, elles partagent entre elles de nombreuses caractéristiques : l’occident a diffusé sa société industrielle au monde entier ; en Asie, le bouddhisme s’est répandu dans des régions à la culture bien différente. Mais parfois, certaines greffes ne prennent pas. Elles sont rejetées après un processus plus ou moins long. Il en est ainsi de la Réforme dans les pays latins, ou du marxisme chez les Anglo-saxons. Ces refus demeurent rares, mais révélateurs, car ce qu’ils repoussent remet en question leurs structures profondes.
Ces rejets peuvent aussi être internes, lorsqu’une civilisation se débarrasse de ce qui ne lui correspond plus. Ainsi, si la folie avait droit de cité au moyen âge, les progrès du rationalisme conduisent peu à peu à l’enfermement des fous.
*
Pour Fernand Braudel, une civilisation c’est donc un espace, une société, une économie, une mentalité collective considérées dans leur continuité historique. Son essence se trouve dans ce qu’elle a de permanent sur le temps long, et elle se révèle dans ce qu’elle refuse d’emprunter aux autres civilisations.
*
« Une civilisation donnée, ce n’est donc ni une économie donnée, ni une société donnée, mais ce qui, à travers des séries d’économies, des séries de sociétés, persiste à vivre en ne se laissant qu’à peine et peu à peu infléchir ».
Fernand braudel, grammaire des civilisations