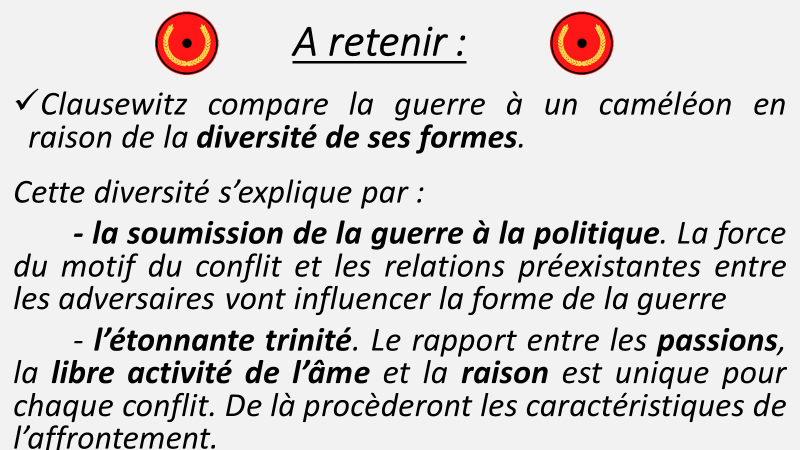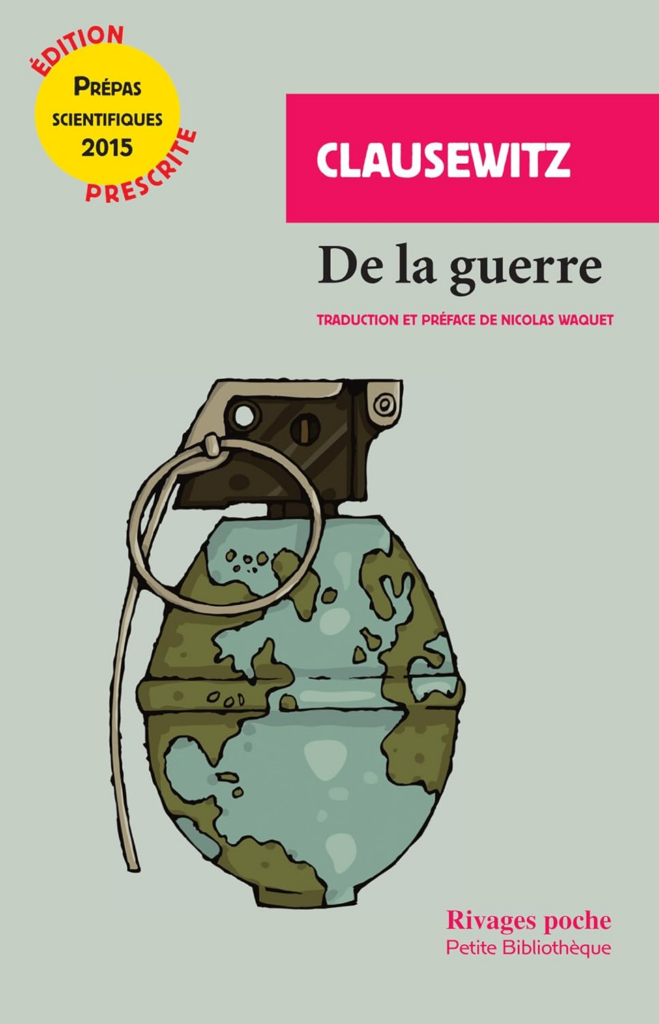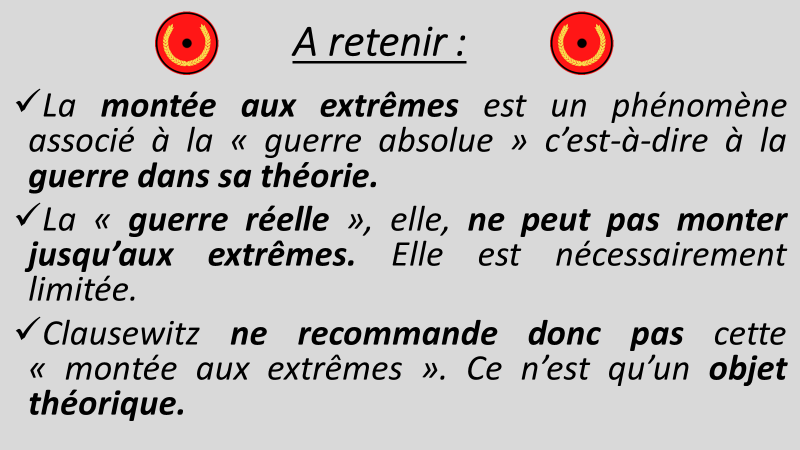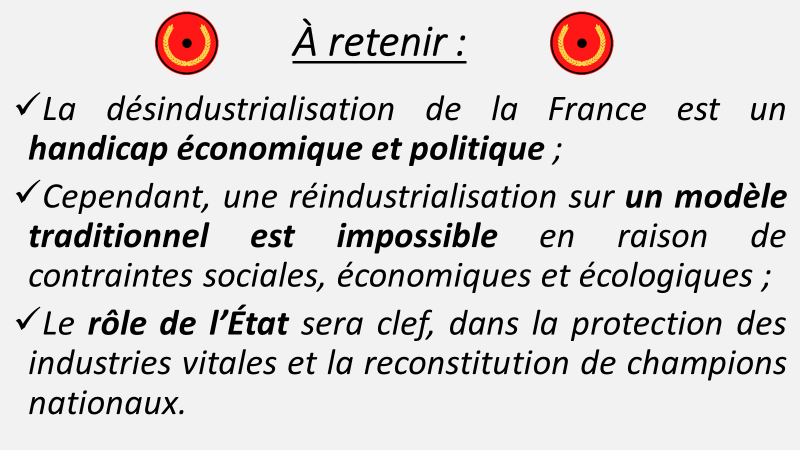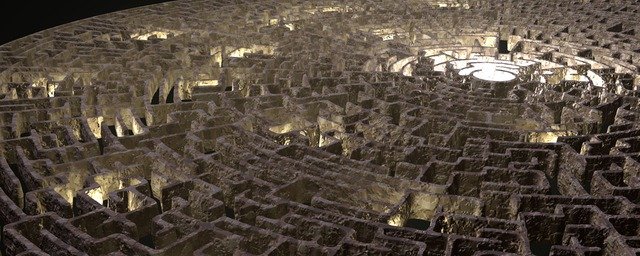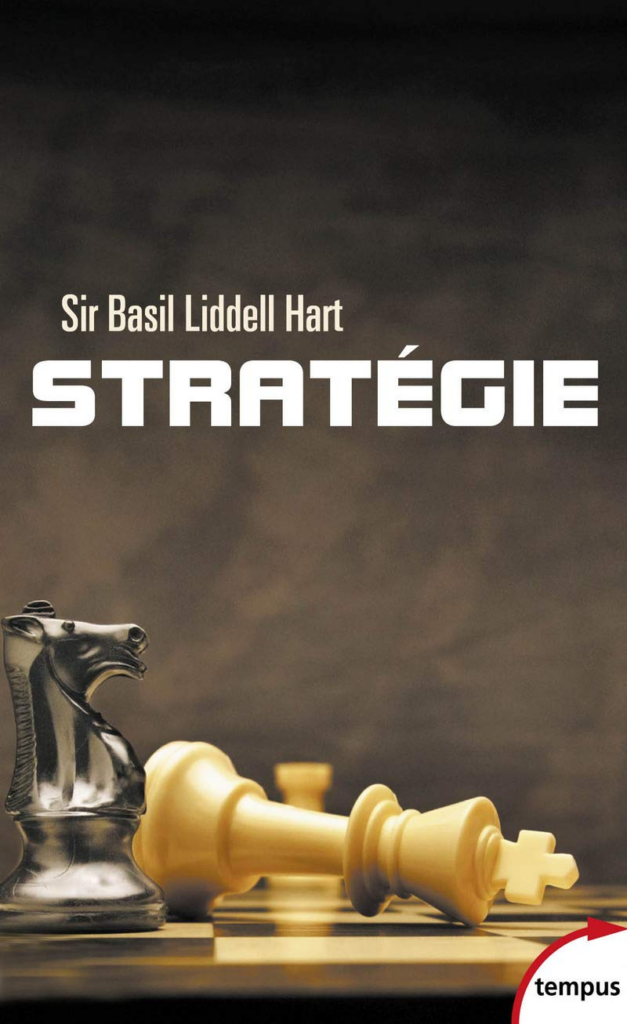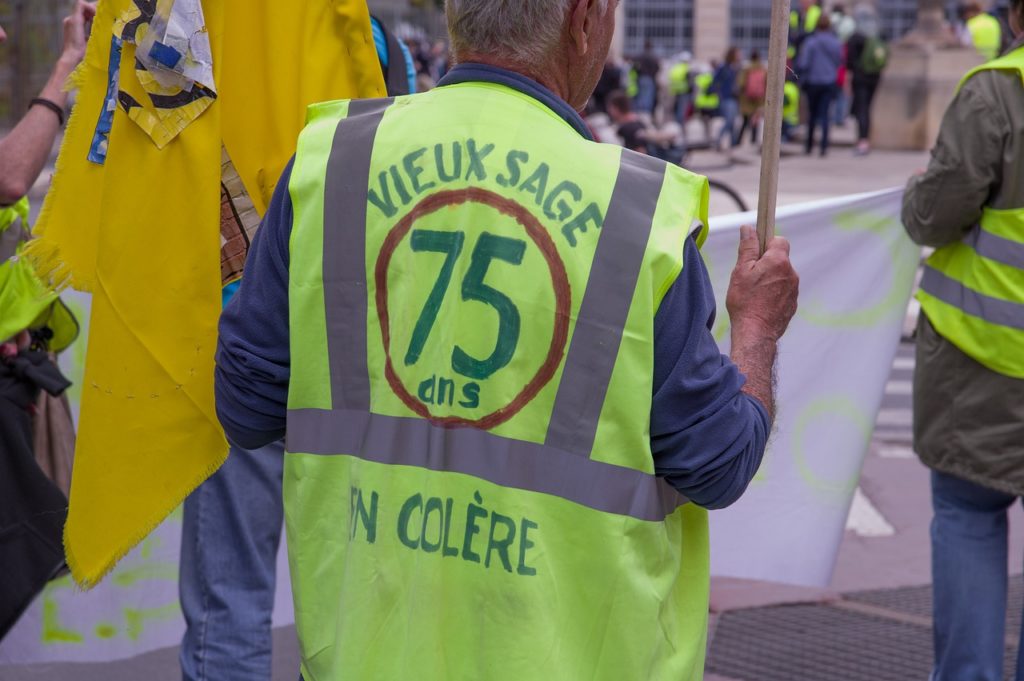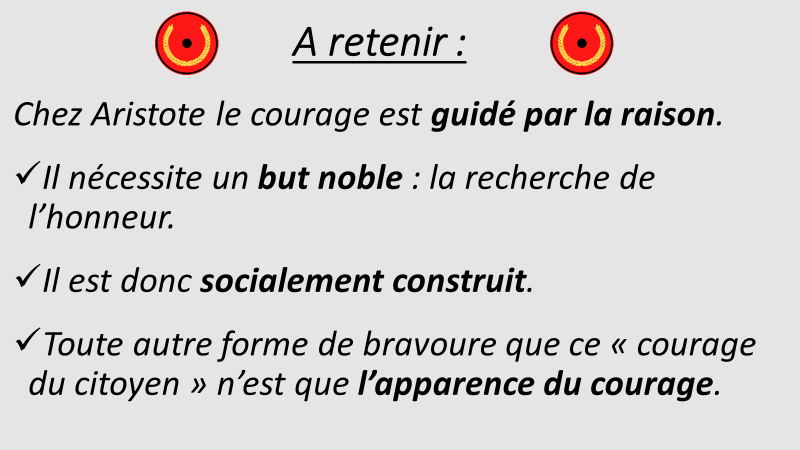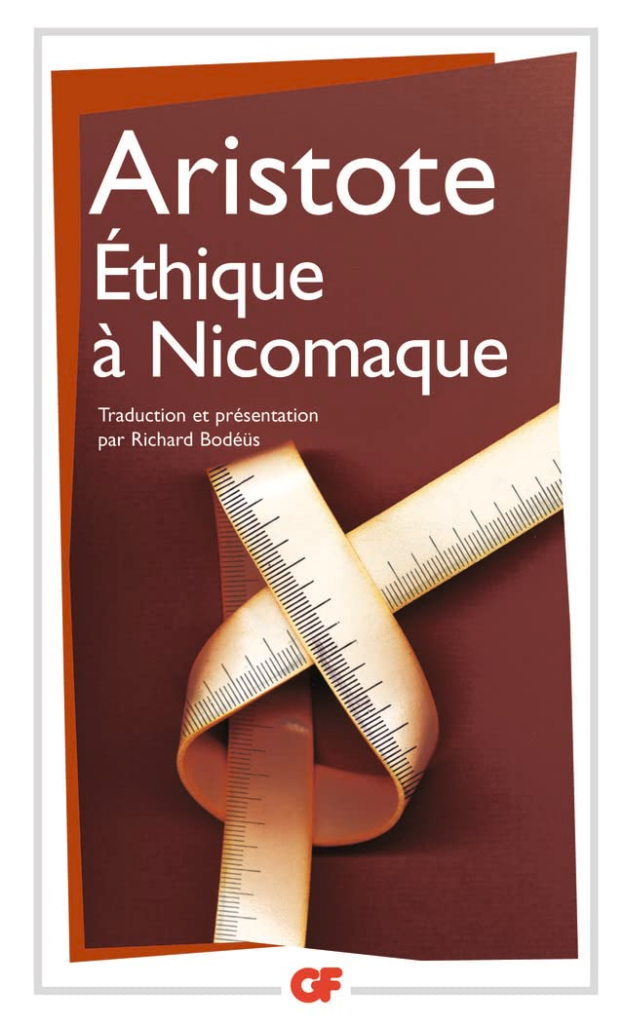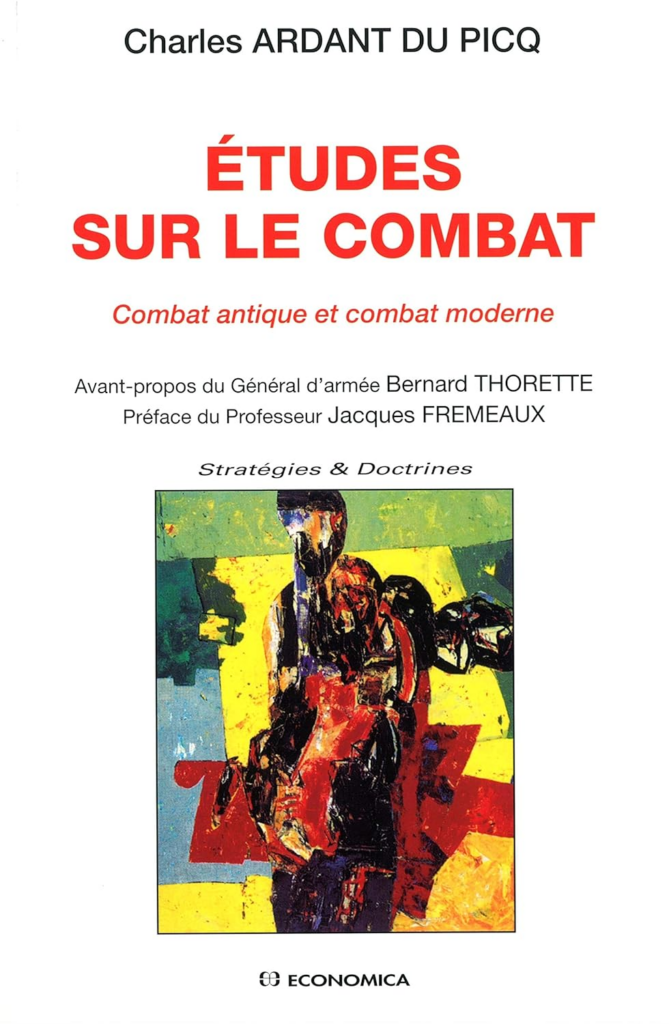« Nous serons un État spatial puissant, dans une Europe spatiale forte ». Cette déclaration de Florence Parly en 2018 restera surement incantatoire. Elle surprend, tant elle est en décalage avec les difficultés de la France et de l’Europe face à la Chine et aux États-Unis, à une époque charnière où l’espace, jusqu’ici militarisé mais sanctuarisé, voit s’ouvrir de nouvelles perspectives stratégiques et pourrait bien se transformer en milieu d’affrontement.
En effet, l’espace fut, est, et probablement restera un milieu privilégié pour l’expression de la volonté de puissance. Place à un tour d’horizon des enjeux stratégiques liés à l’espace et à la place qu’y prend la France.
Selon la fédération aéronautique internationale, l’espace commence à 100 km au-dessus du niveau de la mer, au niveau de la Ligne de Karman. À partir de cette limite, l’atmosphère est si peu dense que les surfaces aérodynamiques ne fonctionnent plus. C’est une limite arbitraire.
Si la physionomie des acteurs de la conquête spatiale subit aujourd’hui de profonds changements, le bouleversement majeur à venir pourrait être la transformation de l’espace en milieu conflictuel. Dans ce cadre, la France conserve la volonté de puissance alliée aux moyens limités qui fait qu’elle est la France.
N. B. : l’exploration spatiale (comme la conquête de Mars) ou les perspectives stratégiques de long terme (par exemple l’éventuelle exploitation des ressources lunaires) ne seront abordées que dans la mesure où elles éclairent les tendances contemporaines, non pour elles-mêmes.
* *
I. Un paysage en mutation.
L’arrivée de nouveaux acteurs comme la Chine ou les entreprises privées ne rebat pas complètement les cartes du jeu de pouvoir dans l’espace. Les États-Unis restent, et resteront longtemps, la puissance dominante dans l’espace.
A. La chine, un entrant majeur.
Ces dernières années, la Chine a fait une entrée spectaculaire dans le club des nations spatiales.
La chine possède un programme spatial abouti. Elle dispose de lanceurs (les « Longue Marche ») et de satellites technologiquement avancés. De plus, elle projette de construire une station spatiale aux alentours de 2022. Une fois que la station spatiale internationale ne sera plus opérationnelle, entre 2024 et 2028, la Chine devrait être la seule nation à disposer d’une station orbitale. Toutefois, elle elle restera de petite taille comparée à l’ISS (60 tonnes contre 450).
Ce programme est à vocation d’émancipation nationale et stratégique. Son objectif est tout à la fois de développer des technologies de pointe et de le faire savoir. L’accès à l’espace est perçu comme le signe de la grandeur retrouvée de la Chine. C’est aussi le symbole de sa réussite.
Elle est en passe de devenir le 2e acteur le plus important de l’espace, derrière les États-Unis. Elle dispose du 2e budget le plus important des agences spatiales, à savoir 11 milliards d’euros en 2018, derrière la NASA (National aeronautics and space administration) et devant l’ESA (European space agency). Ainsi, début 2019 elle a conduit la première mission d’exploration de la face cachée de la lune. En 2019, la Chine est le pays qui a le plus effectué de lancements orbitaux (32, devant la Russie, 22, et les États-Unis, 21)
Sa structure politique lui permet une politique suivie et volontariste. Sa stabilité politique lui donne la capacité de mener un programme régulier sur le long terme, prévu entre 1999 et 2045, contrairement aux États-Unis, où la NASA subit les revirements des différents présidents. En effet, alors que Barack Obama souhaitait délaisser la lune, Donald Trump a relancé l’intérêt pour le satellite en proposant d’y renvoyer des astronautes. Cela dit, l’objectif poursuivi est toujours le même : Mars. La nature autoritaire du régime chinois lui permet enfin d’investir massivement pour démontrer la puissance du pays, et de la faire aux dépens de sa population. Rien ne garantit toutefois que la planification soit tenue. La Chine pourrait elle aussi n’être pas exempte de retournements politiques.
L’entrée de la Chine dans le club des grands pays spatiaux n’est qu’une des transformations que ce connaît ce milieu. Elle ne modifie pas autant le modèle d’accès à l’espace que l’émergence des acteurs privés.
B. L’émergence des acteurs privés.
Les États n’ont plus le monopole de l’accès à l’espace, même si les entreprises privées ne possèdent encore qu’une petite place dans l’architecture de l’accès à l’espace.
Des acteurs privés prennent une place de plus en plus importante auprès des États dans l’accès à l’espace. Space X (Elon Musk), Bue Origin (Jeff Bezos) ou United Launch Alliance (Boeing et Lockheed Martin) sont les compagnies les plus célèbres. En 2019, Space X a procédé à 13 lancements, soit 4 de plus qu’Arianespace. Le secteur du transport d’astronautes vers la station spatiale pourrait être porteur puisque les États-Unis dépendent du lanceur Soyouz pour ces missions depuis le retrait des navettes en 2011. En 2019, Space X a ainsi réussi la mise en orbite de Crew Dragon, un vaisseau destiné au transport d’astronautes. La société assure déjà le ravitaillement de l’ISS depuis 2013.
Ces acteurs développent des technologies de pointe. Ainsi, Space X a mis en service un lanceur très populaire, le Falcon 9, et tente de développer une fusée réutilisable. Autre projet, la mise en orbite des satellites du programme Starlink, qui vise à étendre l’internet à haut débit partout sur la terre. Sa mise en place a débuté en 2019. Enfin, en 2020, Space X a été la première entreprise commerciale à envoyer des hommes dans l’espace. Blue Origin quant à elle tente d’inventer le tourisme spatial avec une fusée capable d’atterrir, New Shepard.
Mais ils sont toujours très dépendants des États. Les principaux clients des entreprises spatiales sont les États. De plus, Space X est dépendante du bon vouloir de l’État américain pour ses lancements. En effet, ce dernier met 3 sites à sa disposition, dont la base de Cap Canaveral. Toutefois, ce paradigme pourrait changer. Les entreprises du « big data » sont de plus en plus attirées vers l’espace. En effet, les satellites ont la capacité de faire transiter rapidement les données, et donc de générer d’importants revenus. Ainsi, Elon Musk mise sur la rapidité du transfert d’information par le réseau Starlink pour financer l’intégralité des activités de Space X.
L’émergence d’acteurs privés est un tournant de l’histoire de la conquête spatiale. À l’inverse, certains acteurs historiques sont à la peine.
C. L’Europe et la Russie, des acteurs historiques à la peine.
La Russie et l’Europe, acteurs traditionnels du secteur spatial, sont confrontées à de fortes contraintes budgétaires et cherchent un second souffle.
L’Europe est confrontée à des difficultés budgétaires et à des divisions politiques qui freinent son ambition spatiale. L’Agence spatiale européenne dispose certes d’un budget de 6,6 milliards d’euros, mais cela ne représente que 10 % des investissements mondiaux. Le programme phare Galileo ne doit pas masquer le manque d’ambition des Européens. S’ils sont en pointe dans de nombreux domaines, force est de constater que les différentes approches de l’espace ne permettent pas de mettre en place de projet majeur. Ainsi, si l’ESA participe au projet d’avant-poste en orbite lunaire de la NASA, elle ne se donne pas d’objectif enthousiasmant comme le font les Américains ou les Chinois dans la course vers Mars. L’idée de « village lunaire » qu’elle a lancée est très imprécise et ne se concrétise pas.
Toutefois, elle tente de maintenir ses positions. L’Europe a développé le lanceur léger Véga et travaille sur Ariane 6 (prévue en 2021). Dès 2021, elle souhaite se doter d’un véhicule spatial réutilisable, le « space rider ».
La Russie lutte également pour conserver ses acquis. En effet, pionnière de la conquête de l’espace, elle possède des savoir-faire très étendus : 10 % des satellites en orbite sont russes, et certains sont capables de manœuvrer. Roscosmos est doté d’un budget équivalent à 5,5 milliards d’euros, et est dirigé depuis 2008 par Dmitri Rogozine, un proche de Vladimir Poutine. Toutefois, les réformes se succèdent depuis 2010 dans l’organisation du secteur spatial russe. Certains échecs, tel celui de la sonde Phobos-Grunt en 2012, ou l’atterrissage en catastrophe d’une fusée Soyouz en 2018 ont été particulièrement marquants.
Le « ticket d’entrée » de l’espace semble s’être abaissé. Si les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Europe en sont les acteurs majeurs, de nombreux autres États disposent aujourd’hui de la capacité d’accès à l’espace (Inde, Iran, Corée du Sud et du Nord, Japon, Israël). 55 pays possèdent des satellites.
Malgré leur volontarisme, les acteurs historiques de la conquête spatiale que sont l’Europe et la Russie ne parviennent pas à mobiliser autour de projets véritablement fédérateurs, à l’inverse des États-Unis qui dominent largement l’espace.
D. La prééminence toujours incontestée des États-Unis.
Malgré les bouleversements récents, les États-Unis restent les maitres incontestés de l’espace.
Les États-Unis possèdent une véritable ambition spatiale. Ils souhaitent notamment installer un avant-poste en orbite lunaire pour se lancer à la conquête de Mars. Les Américains sont sans conteste la première puissance spatiale : ils possèdent 800 satellites actifs (50 % du total).
Les États-Unis disposent d’une avance technique considérable. Les Américains sont pionniers dans un grand nombre de domaines. Ils possèdent par exemple un mystérieux drone spatial, le X37-B, sujet de nombreuses spéculations.
Ils vont maintenir cette avance grâce à un effort financier inégalé. 70 % des investissements publics pour l’espace sont le fait des États-Unis. Le budget cumulé, civil et militaire, des activités spatiales américaines est de 40 milliards de dollars par an. L’écart avec les autres acteurs va donc continuer à se creuser.
L’émergence de la Chine et du secteur privé constitue donc la modification principale du « paysage » spatial aujourd’hui. Mais d’un point de vue militaire, le bouleversement majeur dans l’espace est que nous pourrions bien être à l’aube de son arsenalisation.
*
II. L’espace, un nouveau théâtre d’opérations ?
Longtemps considérée comme lointaine, hypothétique et improbable, les conditions sont aujourd’hui réunies pour faire de l’arsenalisation de l’espace une possibilité à court terme.
A. Différence entre militarisation et arsenalisation
La militarisation de l’espace est un fait établi depuis longtemps, qui diffère de l’arsenalisation que l’on voit poindre aujourd’hui, et que la communauté internationale a tenté d’empêcher.
La militarisation de l’espace est l’utilisation de moyens placés dans l’espace en appui des opérations militaires. Les satellites d’observation et de télécommunication sont des instruments très utilisés qui témoignent de la militarisation de l’espace. Aujourd’hui, les opérations militaires sont même dépendantes de l’espace, pour le renseignement et les télécommunications. Par exemple lors de l’opération Harmattan, les télécommunications entre la métropole et le poste de commandement en mer passaient par satellite.
La militarisation de l’espace est consubstantielle à la conquête spatiale. En effet dès les années 60, pendant la guerre froide, la mise en place de satellites d’observation permettait de surveiller en toute impunité le territoire de l’adversaire.
L’arsenalisation est la mise en place d’armes en orbite, indissociable de la perception de l’espace comme milieu d’affrontement. La communauté internationale a fait plusieurs tentatives pour l’interdire. Par exemple, le traité de 1967 sur l’espace exoatmosphérique comporte des mesures relatives à l’utilisation pacifique de l’espace et interdit la mise en orbite ou le test d’armes nucléaires dans l’espace.
L’espace est donc déjà militarisé, même s’il n’est pas encore un lieu d’affrontement physique ou de positionnement d’armement. L’environnement juridique censé empêcher son arsenalisation est très fragile.
B. Un environnement juridique permissif
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les traités internationaux permettent l’arsenalisation de l’espace.
Le traité international sur l’exploration et l’utilisation de l’espace exoatmosphérique de 1967 permet l’arsenalisation de l’espace. En effet s’il proscrit les armes nucléaires en orbite, il n’interdit pas le placement dans l’espace d’autres types d’armes. Enfin, le transit d’armes nucléaires dans l’espace n’est pas interdit.
Le retrait des États-Unis du traité ABM (pour Anti-Ballistic Missile) de 1972 permet d’envisager l’espace comme une partie du bouclier antimissile américain. En effet, ce traité interdisait formellement le déploiement d’armes ABM dans l’espace.
L’architecture juridique de l’espace permet donc son arsenalisation. Or, le niveau technologique atteint par les puissances spatiales pourrait permettre à court terme l’installation d’armes dans l’espace, et sa transformation en milieu d’affrontement.
C. À l’aube de ruptures technologiques ?
Les avancées technologiques récentes laissent présager une arsenalisation de l’espace qui pourrait avoir lieu sur le court terme.
La Chine et les États-Unis ont démontré qu’elles avaient des capacités antisatellites. En 2007, la Chine a détruit un de ses satellites météo avec un missile balistique. Les États-Unis ont répliqué en 2008 en détruisant un de leurs satellites d’observation, également grâce à un missile. Le problème est que la destruction d’un satellite génère des milliers de débris qui peuvent endommager les autres objets en orbite (dont la majeure partie est américaine).
La Russie est proche du développement d’une arme spatiale. Ainsi le SS-28 Sarmat, un missile balistique, qui peut frapper toute cible sur le globe après une orbite presque complète. De plus, certains de ses satellites sont capables de manœuvrer et d’aborder d’autres objets en orbite.
Les États-Unis ont pris une avance considérable. Le programme X37B, un drone spatial, intrigue les observateurs. Il pourrait servir de plateforme de combat. En outre, dans un contexte de retour de l’espace militaire dans la grande stratégie américaine, Donald Trump a décidé de la création de la Space force. Elle regroupe au sein d’un commandement unique les unités militaires américaines qui surveillent l’espace et y agissent. Elle se met en place pas à pas. Washington maintient une présence dans les discussions internationales, tout en investissant dans des projets de recherche qui pourraient aboutir à des armes spatiales ou antisatellites, tout comme le fait la Chine. L’enjeu pour les Américains est surtout la protection de leurs moyens spatiaux. En effet, ce sont ceux qui en possèdent le plus, et qui par voie de conséquence en sont les plus dépendants.
Nous pourrions donc bien être à l’aube de l’arsenalisation de l’espace, et en tout état de cause les grandes puissances se préparent à des affrontements dans ce milieu.
Dans ce terrain de jeu pour titans, quelle place pour la France ?
*
III. La France, « un État spatial puissant » ?
La France dispose d’une capacité spatiale limitée, mais autonome, qui peine toutefois à s’ouvrir de véritables perspectives dans le contexte de l’arsenalisation de l’espace.
A. Les principes
La politique spatiale française repose sur 3 principes : libre accès à l’espace pour une utilisation pacifique ; préservation de la sécurité et de l’intégrité des satellites dans l’espace ; respect du droit à la légitime défense des États.
La France est opposée à l’arsenalisation de l’espace et à toute initiative qui pourrait relancer la course aux armements dans l’espace. Ainsi, elle est partie au traité sur l’espace de 1967 et respecte implicitement le traité ABM de 1972.
Elle privilégie cependant les mesures de confiance et de transparence à un instrument juridique d’interdiction contraignant, aujourd’hui quasiment impossible à mettre en place. Elle maintient ainsi sa présence dans toutes les discussions concernant l’espace aux Nations Unies.
Sur ses principes s’articulent des capacités bien réelles, même si elles ne peuvent égaler celles des États-Unis ou de la Chine.
B. Une capacité CIVILE ET MILITAIRE, limitée, mais autonome.
La France dispose de véritables capacités autonomes, mais limitées dans le domaine spatial militaire.
Les capacités budgétaires de la France sont limitées. La loi de programmation militaire de 2019 a consacré 3,6 milliards d’euros sur 5 ans. La participation française à l’ESA est de 1,3 milliard d’euros en 2020.
Sur le plan militaire, elle dispose toutefois d’une gamme complète de satellites et de la capacité d’appréciation de situation spatiale : satellites d’observation (CSO, Composante spatiale optique), de télécommunication (Syracuse IV), de ROEM (CERES, en cours de lancement). Elle possède également un commandement unifié de l’espace, le Commandement Interarmées de l’Espace. Il s’appuie sur le Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (COSMOS). Ce dernier a pour fonction de fournir une appréciation très précise de la situation dans l’espace. Il peut également repérer les satellites-espions. Cette capacité d’appréciation de la situation spatiale est unique en Europe.
En dernière analyse, la France est le leader européen dans l’accès à l’espace. Les industriels français possèdent une part prépondérante dans la conception et la fabrication d’Ariane 5. Les lanceurs Ariane et Véga sont tirés depuis Kourou. Enfin, elle est en 2020 le 1er contributeur à l’ESA, avec une participation à hauteur de 26 % du budget total. Elle se pense comme une puissance spatiale militaire : en 2019 elle a présenté sa Stratégie spatiale de Défense.
Si on ne peut la comparer aux États-Unis ou à la Chine, la France est donc un État spatial puissant. Mais le sera-t-elle encore plus grâce à une « Europe spatiale forte » ?
C. Compenser les contraintes budgétaires par la coopération européenne ?
La coopération européenne aura du mal à faire figure de solution aux problèmes budgétaires français, surtout pour développer des capacités militaires dans l’espace.
Il est difficile d’envisager la compensation des difficultés budgétaires françaises par une coopération européenne qui reste peu opérante. Malgré un budget de 6,6 milliards d’euros par an (le 3e mondial), l’agence spatiale européenne (N. B. : qui n’est pas un organe de l’Union européenne) ne propose aucun grand projet fédérateur, si ce n’est le renouvellement des lanceurs Ariane. De plus, elle n’intervient que dans l’activité spatiale civile. Quant à elle, l’UE possède bien un centre satellitaire pour soutenir ses opérations militaires, mais comme il ne possède aucun capteur, il doit acheter ses images à des sociétés privées ou se les faire fournir par les États.
L’absence d’ambition partagée ne permet pas de développer en coopération des moyens spatiaux militaires et des capacités permettant leur protection. En effet, l’Europe de la défense manque encore de contenu. Qui plus est, aucune ambition n’est affichée dans le domaine spatial militaire, hormis des coopérations limitées telles que le partage de l’accès aux données des satellites d’observation.
Si dans l’Europe point de salut, quelles sont les possibilités offertes à la France pour rester cet « État spatial puissant » ?
D. Quelles perspectives ?
Il existe 3 pistes d’approche pour la maintenir l’excellence spatiale française.
a. Maintenir notre crédibilité
- Ne pas se laisser imposer des mesures juridiquement contraignantes. La France doit participer au bon niveau à la préparation des échéances internationales.
- Maintenir le savoir-faire. Poursuivre le développement de lanceurs et de satellites.
- Maintenir la crédibilité du dispositif en renouvelant les satellites d’observation et de télécommunication.
b. Renforcer nos capacités
- Développer des mesures de défense passive et des dispositifs de détection d’agression embarqués. Cela doit permettre de détecter et d’attribuer d’éventuelles agressions.
- Participer à des partenariats technologiques de bon niveau avec les États-Unis et les partenaires européens qui le souhaitent tout en préservant notre autonomie d’accès au service. Par exemple, pour développer des satellites miniatures « en essaim », ou un drone spatial.
c. Développer des mesures actives
- Lancer des études sur les capacités de prévention active. Par exemple sur la capacité de récupération les débris spatiaux ou de réparation des satellites par des moyens automatisés ou télécommandés.
- Lancer des études sur des capacités de défense actives comme les armes antisatellites, en recherchant des synergies avec l’OTAN.
* *
Si de nouveaux venus ont fait leur apparition dans le « grand jeu » spatial, le principal bouleversement à venir pourrait bien être la transformation d’un milieu sanctuarisé en un espace de conflit. Dans cet environnement spatial toujours plus concurrentiel, ni la France ni l’Europe ne semblent en position de faire face à une rupture technologique majeure qui conduirait à son arsenalisation. Finalement, malgré l’abaissement du « ticket d’entrée », l’espace restera la cour des grands qu’il n’a jamais cessé d’être.
Derrière l’espace et ses perspectives stratégiques, se cache en fait la véritable question, celle de la puissance. Les Européens, fatigués et désunis, sont sans en avoir conscience confrontés au dilemme suivant : se donner les moyens de la puissance ou se voir dominer par de grands pays plus enthousiastes. Force est de constater que la réponse de la France n’est pas celle de l’Europe, qui, bien que nous en soyons persuadés, ne s’écrit toujours pas avec un grand « F ».
*
Voir aussi Faut-il réindustrialiser la France ?